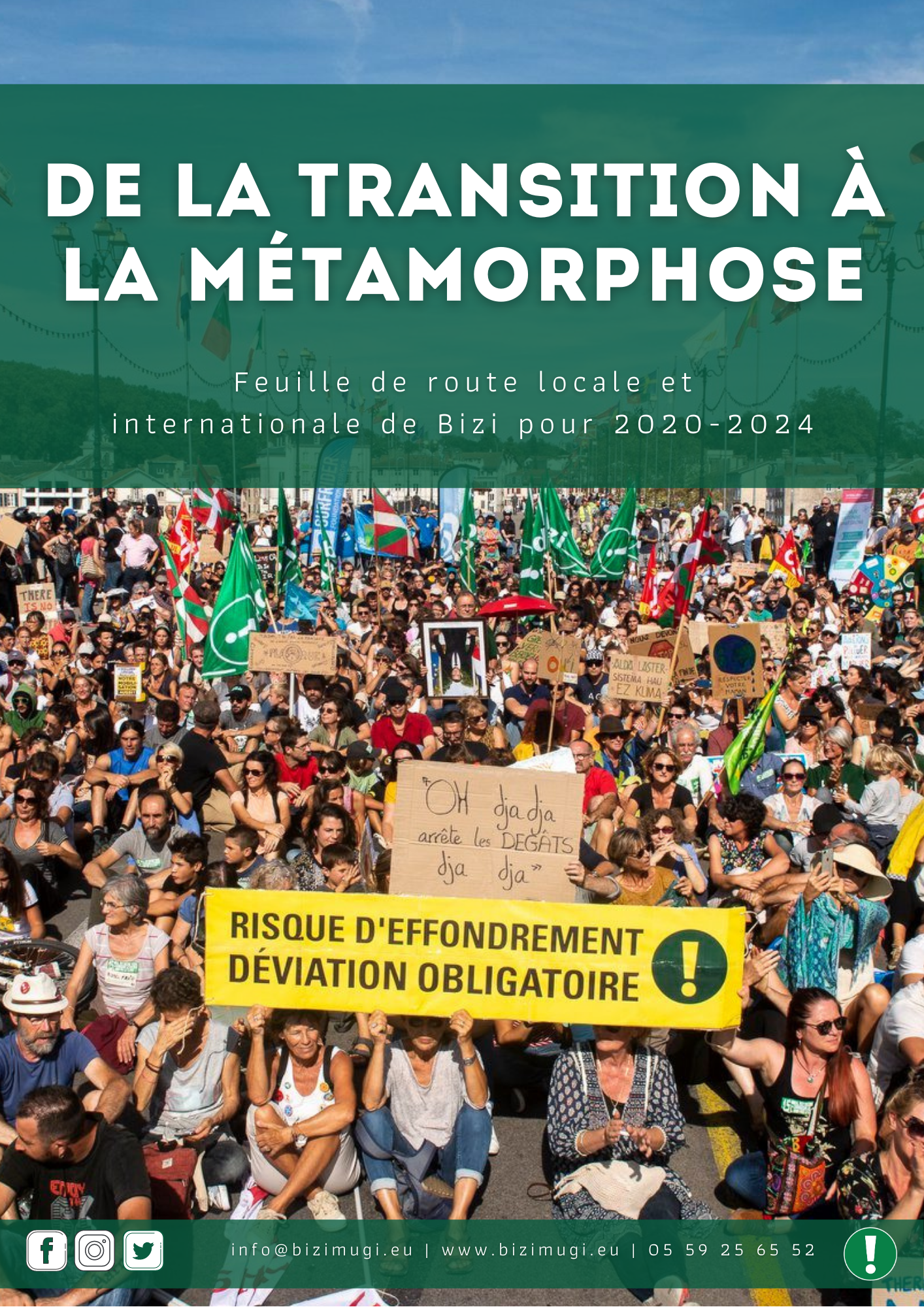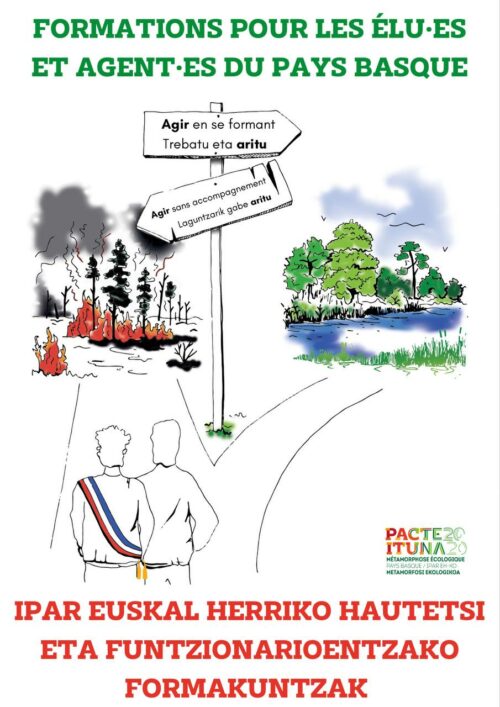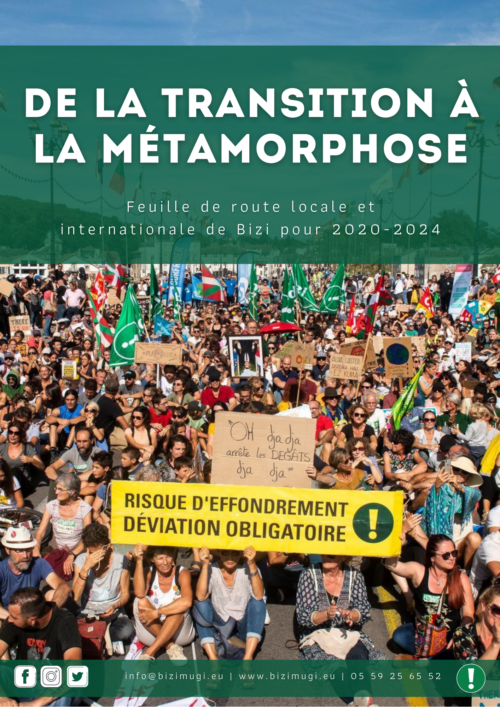Jean Jouzel : « 2 degrés est un objectif politique »
Julien Leprovost
www.goodplanet.info/actualite/2014/11/18/jean-jouzel-deux-degres/
Le changement climatique pour sortir du capitalisme ?
François Bonnet
www.laviedesidees.fr/Le-changement-climatique-pour
Et si l’action locale pouvait changer le monde ?
Weronika Zarachowicz
www.telerama.fr/idees/changer-le-monde-autrement,119037.php#xtor=EPR-126-newsletter_tra-20141120
[:]
Jean Jouzel : « 2 degrés est un objectif politique »
Julien Leprovost
www.goodplanet.info/actualite/2014/11/18/jean-jouzel-deux-degres/
2 degrés, ce simple chiffre est au centre de toutes les discussions actuelles sur le climat et de celles à venir lors du sommet de Paris e, 2015. Climatologue et vice-président du groupe scientifique du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), Jean Jouzel explique l’origine de l’objectif de limitation du changement climatique à deux degrés Celsius d’augmentation des températures moyennes du globe.
Comment est né l’objectif de stabilisation du climat à 2 degrés ?
Stabiliser le climat à 2 degrés Celsius d’augmentation des températures est avant tout une décision politique prise par la Convention climat des Nations-Unies (UNFCCC ou CCNUCC en français). Elle se fonde sur les travaux scientifiques du Giec qui présentent différents scénarios d’évolution du climat d’ici à la fin du siècle. L’UNFCC organise les sommets sur le climat dont celui de Paris en 2015 et tente de fixer des objectifs de stabilisation du climat et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le chiffre de 2 degrés y est évoqué depuis 2003. L’objectif a d’abord été proposé par l’Union européenne puis il a été discuté lors de la conférence de Bali en 2007 avant d’être mentionné dans l’accord de Copenhague en 2009 et adopté à Cancun en 2010. C’est donc un objectif politique au sens noble du terme.
Pourquoi avoir choisi un objectif en degré Celsius ?
C’est un symbole fort et facile à comprendre pour tout le monde tant le lien entre le climat et les températures se montre direct. C’est une mesure plus compréhensible par le public et les décideurs que les PPM (particules par millions) de gaz à effet de serre qui sont employées pour mesurer la proportion de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. De plus, scientifiquement ce seuil nous permet encore de préparer notre adaptation aux nouvelles conditions climatiques.
Et scientifiquement ?
Avec une telle hausse limitée des températures, on espère possible de s’adapter au réchauffement climatique. Si la hausse atteint les 4 degrés d’ici à la fin du siècle alors le réchauffement sera lourd de conséquences et tous les voyants seront au rouge. Avec 2 degrés, certes les océans feront face à une acidification accrue qui affectera la majorité des coraux et la montée du niveau des mers atteindra 40 à 50 centimètres par endroit, mais cela se fera progressivement, nous laissant du temps pour nous adapter.
Comment les scientifiques se sont justement approprié cet objectif ?
Le chiffre a fait l’aller-retour entre les politiques et les scientifiques. Le Giec évoquait déjà cet objectif dans son 4e rapport en 2007, mais c’est vraiment à partir du 5e rapport sorti en 2013 et 2014 que les chercheurs l’étudient, proposent des solutions pour parvenir à stabiliser l’effet de serre.
Enfin, où en sommes-nous de cet objectif de 2 degrés de hausse ?
Depuis le début de l’ère industrielle, les températures moyennes ont augmenté de 0,6 degré Celsius. Il nous reste donc 1,5 degré si on regarde les températures. Mais si on regarde les quantités de gaz à effet de serre émises, il nous reste de 25 à 30 années d’émissions de gaz carbonique au niveau actuel (le plus haut jamais enregistré dans l’histoire humaine). Nous avons déjà émis les 2/3 de notre capital en gaz à effet de serre pour stabiliser le climat à 2 degrés de hausse. Et ce n’est pas un objectif aisé parce que les réserves d’énergies fossiles pas encore exploitées contiennent 5 000 milliards de tonnes de CO2 ; or, pour rester sous la barre des 2 degrés, il ne faut pas en consommer et en rejeter plus que 1 000 milliards de tonnes. C’est un vrai défi que de se limiter, cela implique de changer nos modèles de développement, et c’est tout l’enjeu des négociations sur le climat.
Jean Jouzel
Directeur de Recherches au CEA, Jean Jouzel dirige l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL). Il est membre du bureau du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) depuis 1994 et vice-président de son groupe scientifique. Auteur ou co-auteur de plus de 250 publications, dont plus de 30 dans les revues Nature ou Science, Jean Jouzel constitue une référence incontournable dans le domaine des sciences de l’Univers. Son dernier ouvrage s’intitule : Le climat : jeu dangereux (Dunod, 2007).
Le changement climatique pour sortir du capitalisme ?
François Bonnet
www.laviedesidees.fr/Le-changement-climatique-pour
Aucun problème au monde n’est plus important que le changement climatique. Dans son dernier ouvrage, Naomi Klein entend montrer que lutter contre le réchauffement de la planète implique de sortir du capitalisme. Mais comment ?
Recensé : Naomi Klein, This Changes Everything : Capitalism vs. The Climate, Simon and Schuster, 2014, 576 p.
This Changes Everything (« this » est le réchauffement climatique) explore les façons dont nous pourrions échapper aux catastrophes et aux dévastations qui vont accompagner l’augmentation de la température mondiale. Ce n’est pas un livre académique, ni un recueil des données scientifiques sur le changement climatique ; Naomi Klein n’essaie pas de convaincre le lecteur de la réalité du problème. L’auteure est une journaliste et militante canadienne dont le premier livre, No Logo, s’est vendu à un million d’exemplaires et a participé à l’essor du mouvement altermondialiste. La stratégie du choc, son second livre, a également été un best-seller mondial. This Changes Everything défend la thèse que la soutenabilité écologique n’est pas compatible avec le capitalisme ; et que le changement climatique et ses menaces gravissimes sont une opportunité pour se débarrasser du capitalisme — puisque à long terme il faudra de toutes façons choisir entre capitalisme et survie de l’espèce. This Changes Everything est une intervention dans le débat public par une professionnelle des mouvements sociaux et une idéologue de premier plan de la gauche des années 2000.
Capitalisme contre climat
Pour Naomi Klein, rien n’illustre mieux le lien entre capitalisme et réchauffement climatique que le droit du commerce international et l’Organisation Mondiale du Commerce. À l’OMC, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre se mènent les uns contre les autres une guerre juridique pour annuler les subventions pour les énergies renouvelables des autres pays. Toute politique visant à favoriser les circuits courts est assimilée à du protectionnisme, et donc susceptible de recours auprès de l’OMC, où des juges rendent des décisions cruciales pour l’avenir de la planète avec pour seul référent les accords signés par les États. Au sommet de Rio en 1992, il avait été convenu que les mesures contre le réchauffement climatique ne pouvaient pas servir de « restriction déguisée » au commerce international. L’organisation de la libre circulation des capitaux permet aux capitalistes de parcourir le monde à la recherche de la main d’œuvre la moins chère, et où les normes environnementales sont en général inexistantes. Comme dit Naomi Klein, le travail à bas coût et l’énergie sale forment un « paquet ». Lutter contre le réchauffement nécessite donc de sortir du capitalisme.
This Changes Everything recense ce qui ne marchera pas pour lutter contre le réchauffement. Rien à attendre des grandes ONG environnementales comme Nature Conservancy ou Environmental Defense Fund, qui sont pour la plupart corrompues par les multinationales. Rien à attendre non plus des milliardaires philanthropes, auxquels un chapitre est consacré. Rien à attendre encore des petits gestes du quotidien. Surtout, rien à attendre d’un marché des émissions, dont les effets pervers sont manifestes : en Inde, toute une industrie fabrique des polluants pour les détruire aussitôt et empocher les subventions environnementales. Pas grand-chose à attendre du geoengineering (que préconisent Bruno Latour ou Stephen Hawking), qui consiste non pas à réduire les émissions mais à agir sur les effets du réchauffement climatique, en pratiquant la séquestration de carbone ou la dispersion de souffre dans l’atmosphère pour faire baisser la température (une solution promue par les auteurs de Freakonomics [1]). Le geoengineering recèle un potentiel inépuisable d’effets pervers et ne peut être que le dernier recours d’une planète à la dérive. Les humains feraient mieux de changer radicalement de mode de vie.
Comment changer de mode de vie ? Cela pose le problème des conditions politiques de la mise en œuvre de politiques environnementales. Un point intéressant du livre est que Naomi Klein n’a aucune foi dans la démocratie électorale. Elle n’a pas un mot sur les élections (à part pour souligner que Bill Clinton et Jean Chrétien ont renié leurs promesses de campagnes sur l’ALENA) ni sur les partis écologistes. Le constat implicite est qu’il n’y a rien à attendre des élus, qui finissent toujours par travailler pour les intérêts des multinationales : la démocratie libérale est incapable de faire autre chose que dévaster la planète. Seul les mouvements sociaux et les manifestations organisées par la base (grassroots) peuvent occasionnellement faire reculer les gouvernements et les multinationales ; et en même temps, Naomi Klein souligne qu’en matière d’écologie, on ne peut se contenter de politiques incitatives, il faut mettre en œuvre des interdictions fermes (par exemple sur la fracturation hydraulique). Mais This Changes Everything parle très peu de politiques publiques : tout changement repose sur des mouvements sociaux vigoureux et revendicatifs, de façon à faire évoluer les modes de vie occidentaux vers le rapport que les peuples indigènes entretiennent avec la nature.
Dans ces luttes, nous dit Naomi Klein, il faut partir du principe que les ressources de l’État sont au service du capital. Par exemple, le bureau de Homeland Security de Pennsylvanie a partagé ses dossiers sur les organisations écologistes anti-fracking avec les compagnies pétrolières, et l’entreprise publique française EDF a illégalement espionné Greenpeace. La police réprime toujours les manifestants, et non les multinationales qui produisent les gaz à effet de serre. Un exemple de collusion entre État et industrie pétrolière est celui du delta du Niger. L’extraction du pétrole est particulièrement polluante ; on estime que depuis 50 ans, c’est l’équivalent d’un Exxon Valdez [2] tous les ans qui est déversé sur les côtes. Shell, en particulier, pratique le torchage (flaring) : au lieu de récupérer le gaz naturel qui s’échappe lors de l’extraction, on y met le feu, ce qui est à la fois un gaspillage et une pollution énorme. Quand les protestations du peuple des Ogoni, qui habite dans le delta, sont devenues trop éloquentes, une brutale répression menée par la junte militaire nigériane a fait des centaines de morts, dont le poète et dramaturge Ken Saro-Wiwa, pendu avec huit compagnons au terme d’un procès truqué, le tout pour faciliter les opérations de Shell.
Naomi Klein souligne que l’une des données du problème est que les compagnies pétrolières sont perpétuellement en train de révolutionner les moyens d’extraction, notamment avec l’essor de la fracturation hydraulique et le forage dirigé (horizontal drilling). Chaque nouvelle source d’hydrocarbures (les sables bitumineux de l’Athabasca [Alberta tar sands], les gaz de schiste aux États-Unis) accélère la quantité de particules envoyée dans l’atmosphère, contribue au réchauffement climatique, qui entraîne la fonte des glaciers, de la calotte polaire et du pergélisol (permafrost), lesquelles vont relâcher de très importantes quantité de dioxyde de carbone, accroissant encore le réchauffement. Il n’y a aucune raison que cela s’arrête, puisque les compagnies pétrolières sont les entreprises les plus riches, les plus rentables et les plus puissantes du monde économique.
Romantisme des mouvements sociaux
This Changes Everything a beaucoup de mérites, en premier lieu celui de parler du changement climatique et de rappeler l’urgence de la question : l’augmentation de la température mondiale de deux degrés est inévitable, mais une action drastique au cours de la prochaine décennie pourrait empêcher une augmentation de quatre degrés. Nous n’avons aucun temps à perdre et c’est le mérite de Naomi Klein de le rappeler, en consacrant son travail et sa notoriété à publiciser le problème. Le livre fourmille de faits, d’histoires et de données qui ne peuvent que conduite le lecteur à avoir mieux et plus conscience des enjeux du changement climatique. Son but est de mobiliser, et en cela il fonctionne bien.
Cela dit, This Changes Everything nous en dit plus sur l’état de la pensée progressiste d’un certain militantisme environnemental que sur les voies et moyens d’un hypothétique dépassement du capitalisme. Et de ce point de vue, le livre est un peu déprimant.
La principale contradiction du livre est de se focaliser sur les mouvements sociaux, les manifestations et les mobilisations de la base, alors que l’ampleur de ce qu’il faut réaliser dépasse de beaucoup le champ d’action des mouvements sociaux. Une remise en cause fondamentale du capitalisme dépasse le cadre des protestations locales. La mise en œuvre d’interdictions strictes (de forage, d’utilisation de polluants) et la réduction massive des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas du ressort de communes autogérées. Naomi Klein a certainement raison de ne placer aucune espérance dans la démocratie électorale, où les intérêts économiques et les calculs électoraux à court-terme tendent à primer sur considérations environnementales. Mais elle est trop optimiste sur le pouvoir des mouvements sociaux ou sur l’exemple des peuples indigènes qui résistent aux multinationales. Dans son livre, on ne voit pas comment on pourrait passer des mobilisations locales à une transition planétaire en dehors du capitalisme. D’aucuns pourraient d’ailleurs penser qu’au bout du compte, seul un pouvoir autoritaire pourrait mettre en œuvre les changements nécessaires. Le modèle de la société durable de Naomi Klein est celui des peuples indigènes : une société sans géopolitique, sans politiques publiques, qui seraient magiquement débarrassées de l’influence néfaste du lobby pétrolier grâce aux mobilisations citoyennes. Ce n’est pas que cette société soit impossible, mais elle est inenvisageable dans les dix ans à venir. Or, et c’est Naomi Klein qui le dit elle-même, il faut absolument agir dans les dix ans qui viennent. Du coup, l’espèce d’incantation new age sur le retour à la nature sonne comme une forme de résignation paradoxale sur l’inéluctabilité du changement climatique.
En particulier, le refus par Naomi Klein de discuter sérieusement de la mise en œuvre d’une taxe carbone et d’un marché des émissions témoigne d’une forme de romantisme qui n’est pas constructif. Il est probable que des mouvements sociaux puissants soient nécessaires pour mettre en œuvre ce type de politiques publiques ; il est certain que dans la réalité de 2014, une taxe carbone significative et un marché des émissions restrictifs sont plus efficace pour réduire les émissions qu’une hypothétique interdiction des énergies fossiles.
Naomi Klein n’évoque pas la question du pic pétrolier (peak oil), l’idée qu’on arrive à épuisement des ressources en pétrole et gaz. Or cette question est centrale. Ou bien le peak oil implique un renchérissement du pétrole qui rend mécaniquement les énergies renouvelables rentables et réduit tout aussi mécaniquement les émissions ; ou alors, le peak oil est significativement repoussé à cause de l’exploitation des gaz de schiste et des sables bitumineux (la question est sujette à controverse). Si le pétrole ne se raréfie pas, comme semble le suggérer l’auteure, le passage aux énergies renouvelables doit être un choix politique et non la conséquence d’une contrainte naturelle. Dans cette perspective, le problème semble être moins le capitalisme que le pouvoir politique des intérêts pétroliers aux États-Unis et au Canada (une conclusion cohérente avec l’argument du livre). On aurait aimé que This Changes Everything fasse le point sur la question.
Enfin, le livre ne parle pas de la question démographique. Naomi Klein fait comme si le seul problème était celui des modes de vie. Mais il n’est pas évident que la Terre puisse nourrir plusieurs milliards d’humains supplémentaires. L’agriculture productiviste n’est pas écologiquement soutenable. Le problème est donc de déterminer le nombre d’humains qui pourraient se nourrir avec une agriculture durable. Si on imagine une parfaite répartition de la production, on peut peut-être nourrir 11 milliards d’humains (la projection moyenne pour 2100). Mais cette répartition parfaite est illusoire : dans le monde réel, la distribution de la nourriture sera archi-inégalitaire, avec tous les problèmes qu’on imagine, et dans un contexte amplifié par les sécheresses provoquées par le changement climatique dans les pays du sud. En somme, aucune perspective n’est réjouissante, mais au moins This Changes Everything nous fait parler des questions centrales.
Et si l’action locale pouvait changer le monde ?
Weronika Zarachowicz
www.telerama.fr/idees/changer-le-monde-autrement,119037.php#xtor=EPR-126-newsletter_tra-20141120
A Bristol, à Fukushima, en France, des héros ordinaires se battent pour rendre la vie meilleure. Et inventer une autre ère énergétique et économique.
Ils sont français, brésiliens, allemands ou canadiens. Ils créent des monnaies locales, des jardins communautaires, des parcs éoliens citoyens, des entreprises coopératives. Ces « lanceurs d’avenir », comme les appelle Marie-Monique Robin dans son dernier documentaire, Sacrée Croissance !, s’aventurent dans de nouvelles façons de vivre, consommer ou produire, à l’heure où les promesses de l’abondance capitaliste s’évanouissent.
Ils préfèrent le « mieux » au « plus », sèment les graines de ce que pourrait être une société « post-croissance », et revitalisent les questions de l’écologie, de la démocratie et de la politique. Avec un point commun, par-delà la diversité des expériences : ces « héros » ont tous choisi l’action locale.
« Partout en France, dans l’angle mort des médias, des gens ordinaires prouvent que la transformation sociale n’est pas le privilège des puissants, analyse Emmanuel Daniel, auteur du Tour de France des alternatives. Ils […] n’attendent plus de sauveur providentiel pour agir. Partant du constat que ni l’Etat ni le marché n’ont la capacité, la volonté, voire la légitimité, d’organiser efficacement et durablement leurs existences, ils ont décidé d’œuvrer eux-mêmes pour transformer leur vie et celle des autres autour d’eux. »
Difficile d’évaluer l’ampleur de cette « espèce de mouvement social potentiel », le nombre de ces « défricheurs » décrits par Eric Dupin dans un des livres revigorants parus cet automne sur le sujet (1). Ces « petits bouts d’utopie », comme les nomme Emmanuel Daniel, forment un puzzle éclaté, fait de « décroissants », « transitionneurs », « zadistes » ou « alterconsommateurs »…
Faire renaître l’espoir
Minorité agissante ou véritable foisonnement, ils se battent en tout cas contre le sentiment d’impuissance né de la multiplication des constats dramatiques – raréfaction des ressources, crise des écosystèmes, péril du réchauffement climatique, etc. Ils prouvent que « chacun a sa place dans le changement social », et font « renaître l’espoir », écrit Emmanuel Daniel.
A leur manière aussi, ils prennent acte des échecs du mouvement écologiste, qui, depuis quarante ans, n’a pas réussi à convaincre la société qu’elle devait changer avant que ne soit atteint le pic pétrolier (moment où la production décline par épuisement des réserves exploitables).
Il s’agit de rêver d’un changement dont chacun pourrait être l’acteur, à travers le fameux empowerment – « développement du pouvoir d’agir » des individus –, cher aux Anglo-Saxons. « Pas de rêver, les solutions sont déjà à l’œuvre ! », corrige le Britannique Rob Hopkins, auteur d’Ils changent le monde !
Basculer dans une autre ère
En 2006, ce professeur de permaculture (2) a lancé le mouvement des Villes en transition à Totnes, petite ville conservatrice, pour sensibiliser ses habitants au problème du pic pétrolier et organiser localement « un basculement dans une autre ère énergétique et économique ».
Conçue comme une « détox » à usage de citoyens occidentaux biberonnés au toujours plus, la Transition a essaimé dans cinquante pays, grâce à des milliers d’initiatives inventées à l’échelle d’un quartier, d’une ville, et toujours adaptées à leur contexte – monnaie locale à Bristol, coopérative d’énergie renouvelable au Japon après Fukushima, plan de diminution énergétique à Totnes, agriculture urbaine à Montréal…
Souvent présentée comme le mouvement écolo anglo-saxon ayant connu la plus forte croissance ces dix dernières années, la Transition a défini un nouvel état d’esprit : optimiste et constructif, fait de délibération locale, de révolutions minuscules qui « permettent d’avancer sous les radars, et d’éviter les résistances qu’on rencontre dès qu’on s’attaque à un niveau plus global », dit Rob Hopkins.
“Consommateur ou électeur, chacun devient co-inventeur de solutions”, Olivier De Schutter, rapporteur des Nations unies sur le droit à l’alimentation
C’est une forme de micropolitique. Capable de redéfinir les modèles économiques locaux et d’ouvrir de nouvelles voies à la démocratisation : chacun n’est plus seulement « acheteur passif de biens et de services (en tant que consommateur) ou de programmes politiques préformatés (en tant qu’électeur), il devient co-inventeur de solutions », écrit Olivier De Schutter, le rapporteur des Nations unies sur le droit à l’alimentation, dans la préface du livre de Hopkins. « Nous n’attendons pas la permission des politiques, nous agissons directement, insiste Rob Hopkins. Notre défi, c’est de rassembler ces expériences, de les mettre sous le nez des politiques en leur disant : qu’est-ce que vous attendez pour passer à une autre échelle ? »
Une approche militante et stratégique ultra pragmatique, et différente de celle de leurs cousins français de la décroissance, qui adoptent une position plus idéologique et macroéconomique, où l’Etat garde une place centrale (réduction du temps de travail, revenu universel garanti…). Cet agir local, nouveau mantra alternatif, est aussi à distinguer du Larzac des années 70, souligne Hervé Kempf dans son beau récit sur la ZAD (Zone à défendre) de Notre-Dame-des-Landes, autre exemple d’expérimentation créative : « Il ne s’agit pas de “vivre et travailler au pays” […], mais de vivre et de transformer le monde. » Les zadistes ne sont pas venus « seulement avec la volonté de vivre là, mais aussi de s’émanciper du système dont le projet d’aéroport n’est qu’un symptôme ».
Transformer les mentalités
Rob Hopkins qualifie la Transition de mouvement culturel plus que politique : « Le vrai travail est de transformer les mentalités et la culture locale pour s’adapter au changement post-pétrole et post-croissance, nous rendre résilients et nous réinventer. A Totnes, nous avons d’abord travaillé sur la façon de raconter notre histoire commune ; nous avons inventé des scénarios : à quoi pourrait ressembler, par exemple, notre ville en 2030 ? Petit à petit, la “transition” est entrée dans le vocabulaire des habitants, pour parler de la manière dont ils se voient et voient le monde… » Pour exprimer, ensemble, leurs peurs, leurs questionnements, face à l’annonce que notre civilisation pourrait disparaître.
« Totnes a réussi un long travail d’accompagnement émotionnel et narratif, un “storytelling” de la catastrophe, observe Luc Semal, chercheur au Muséum national d’histoire naturelle et observateur aiguisé des politiques locales de décroissance. Comme avec le “catastrophisme éclairé” du philosophe Jean-Pierre Dupuy, ce storytelling se fonde sur la conviction que nous sommes dans une période de basculement du monde, à laquelle il faut se préparer matériellement et psychologiquement. »
Dépasser le clivage droite-gauche
Parler culture permet de s’adresser au plus grand nombre, au-delà des affinités politiques, culturelles et générationnelles. Le caractère pragmatique des objectifs poursuivis (relocaliser l’économie, manger sainement, lutter contre le gaspillage alimentaire…), aussi. Quant aux thèmes localistes, ils « font écho tant aux valeurs chères aux progressistes (telle que la solidarité) qu’à celles portées par les conservateurs (autonomie, responsabilité) », rappelle Emmanuel Daniel. Et conduisent à dépasser le clivage droite-gauche.
Toute la force du combat local se trouve là. Mais ses fragilités aussi. Comment passer, en effet, du local au global, sachant que les enjeux sont mondiaux ? « Jusqu’où le système politique institutionnel est-il disposé à intégrer la proposition des villes en transition ? s’interroge Luc Semal. Le discours positif sur l’animation d’une vie collective locale, la renaissance d’une économie locale, est facile à adopter. Mais comment faire entendre aux institutions actuelles que “pic pétrolier” signifie, à terme, arrêt de la croissance telle que nous l’avons connue… »
Voyons combien le concept de « transition » s’est affadi dans la dernière loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Celle-ci « reste sur une conception classique du progrès technique, qui ne colle pas avec le cadrage idéologique proposé par Rob Hopkins : une pensée politique de la catastrophe […], qui milite dans un contexte de basculement global, d’une ère de croissance vers une ère de pénurie énergétique ».
Il y a donc fort à parier, souligne Eric Dupin, que « la transition citoyenne n’ira pas sans heurts, sans ruptures, sans batailles ni contradictions ». Mais elle a déjà gagné, mine de rien, une première manche : elle a inventé, dit Luc Semal, « l’un des seuls mouvements qui portent un discours post-croissance abouti, et l’accompagnent de solutions concrètes et positives ». C’est subversif et infiniment précieux.
(1) Dans les pas d’ouvrages devenus références : L’Emergence des créatifs culturels. Enquête sur les acteurs d’un changement de société, de Paul H. Ray et Sherry Anderson (2001), Un million de révolutions tranquilles, de Bénédicte Manier (2012), Notre-Dame-des-Landes, d’Hervé Kempf (2013).
(2) Créée dans les années 70 et inspirée du fonctionnement des écosystèmes naturels, la permaculture conçoit des cultures, des lieux de vie, des systèmes agricoles, durables, résilients, économes en travail comme en énergie.
A voir, à lire
Sacrée Croissance !, de Marie-Monique Robin : un film, en DVD, un site et un livre (11 déc.), éd. La Découverte.
Le Tour de France des alternatives, d’Emmanuel Daniel, éd. Seuil/Reporterre, 138 p., 10 €.
Ils changent le monde !, de Rob Hopkins, coll. Anthropocène, éd. Seuil, 204 p., 14 €.
Les Défricheurs, d’Eric Dupin, éd. La Découverte, 278 p., 19,50 €.
Faire de la société un bien commun essentiel, manifeste sur le site Spiral.